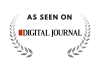Accusant l’Iran de violer ses engagements nucléaires, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont enclenché, fin août, une procédure visant à rétablir les mesures coercitives qui visaient le pays avant l’accord de Vienne de 2015. Ce mécanisme dit de « snapback », ou retour en arrière, autorise tout signataire de l’accord à demander un rétablissement des sanctions en cas de non-respect par Téhéran de ses obligations. Le Conseil dispose alors de 30 jours pour s’opposer à une telle demande. À l’issue de ce délai, les sanctions sont automatiquement rétablies.
Techniquement, les membres du Conseil ont encore un peu plus d’une semaine pour adopter une résolution similaire à celle rejetée vendredi. Un tel scénario supposerait une percée diplomatique dans les jours à venir.
Négocié il y a dix ans dans la capitale autrichienne, le Plan d’action global commun avait pour but de garantir le caractère strictement pacifique du programme nucléaire iranien, sous la surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), en échange d’un allégement des sanctions contre le pays.
Mais l’édifice, fragilisé depuis le retrait des États-Unis en 2018, s’est fissuré au fil des années, au point de paraître aujourd’hui à bout de souffle.
L’escalade de l’été
L’alerte avait été lancée au mois de juin par l’AIEA. Selon son directeur général, Rafael Grossi, Téhéran dispose désormais de plus de 400 kilos d’uranium enrichi à 60 %, un seuil proche du niveau requis pour fabriquer l’arme nucléaire. « Une telle accumulation ne peut s’expliquer par un usage civil crédible », avait-il averti. Les inspections de certains sites étant bloquées depuis 2021, l’agence avait reconnu avoir « perdu la continuité de sa connaissance » du programme iranien.
Le Directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi.
Ces constats alarmants se sont accompagnés, durant l’été, d’une escalade militaire entre l’Iran et Israël. Pendant plusieurs jours, Tel Aviv a bombardé des sites nucléaires et militaires iraniens, entraînant des frappes de représailles. Le 21 juin, l’armée américaine a ciblé trois installations sensibles à Fordo, Ispahan et Natanz. Si l’AIEA a assuré qu’aucune hausse de radiation n’avait été détectée, la confrontation a accentué les craintes d’un embrasement régional.
Dans ce contexte, les Européens ont choisi d’appuyer sur l’interrupteur nucléaire diplomatique le mois dernier, en déclenchant la procédure de snapback. Pour Londres, Paris et Berlin, il s’agit autant de sauver ce qui peut l’être de l’édifice de Vienne que de contraindre Téhéran à revenir à la table des négociations, alors que le Plan d’action global commun arrive à expiration le 18 octobre.
Une lueur d’espoir a accompagné la conclusion, le 10 septembre, d’un accord entre l’AIEA et l’Iran ouvrant la voie à la reprise des inspections dans les sites nucléaires du pays, suspendues depuis l’escalade militaire de juin. M. Grossi a salué à cette occasion « un pas important dans la bonne direction ».
Contestation de la Russie et de l’Iran
Pour la Russie, la procédure activée par la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, est nulle et non avenue. Son ambassadeur, Vasily Nebenzya, a jugé que la « prétendue notification » par les trois pays du déclenchement du mécanisme, dans un courrier adressé au Conseil le 28 août, n’avait « aucune force juridique au procédural ».
Invité à la réunion du Conseil, l’ambassadeur iranien, Amir-Saeid Iravani, a également contesté la validité de cette notification, tout en dénonçant la politique du « deux poids de mesure » manifestée par les frappes du mois de juin sur son pays.
« Le programme nucléaire iranien ne sera pas détruit par des bombes, ni modifié par des sanctions ou écarté de sa voie pacifique. […] La porte de la diplomatie n’est pas fermée. Mais ce sera l’Iran, non pas ses adversaires, qui décidera avec qui discuter », a-t-il dit.
Washington, Paris et Londres assument le « snapback »
Côté britannique, la lecture est strictement procédurale. Pour l’ambassadrice Barbara Woodward, tout ce qui est nécessaire pour un retour des sanctions, est une notification par un État signataire d’une violation des engagements iraniens. « Et c’est tout ! ».
Les États-Unis en tirent les conséquences : « Faute de nouvelle action du Conseil, les sanctions de l’ONU contre l’Iran d’avant 2015 sont réimposées à l’issue de la période de rétablissement de 30 jours, le 27 septembre », a tranché la représentante américaine Dorothy Shea, tout en soulignant que ce rétablissement « n’empêche pas une véritable diplomatie ».
La France a insisté sur l’escalade du programme iranien et sur l’offre d’extension temporaire déposée par les Européens. « Nous n’avons donc d’autre option que de soutenir la poursuite de la procédure de snapback », a expliqué l’ambassadeur Jérôme Bonnafont, tout en rappelant les conditions de l’offre européenne actuellement sur la table pour une sortie de crise négociée : « reprise d’une coopération effective […] avec l’AIEA » – y compris l’accès aux sites sensibles –, des « rapports spéciaux », notamment sur l’uranium enrichi à 60 %, et la « reprise de négociations directes et sans condition avec les États-Unis ». Et de préciser : « Notre offre d’extension reste sur la table jusqu’à la fin du délai des 30 jours ».
Sauf inflexion diplomatique rapide, la perspective d’un prochain rétablissement des sanctions contre l’Iran et, avec lui, de l’effondrement de l’accord de Vienne, se rapproche à grands pas.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.com).
To submit your press release: (https://www.globaldiasporanews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.globaldiasporanews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.globaldiasporanews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.