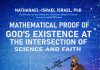Dans sa maison de Jalalabad, à une cinquantaine de kilomètres de l’épicentre, Abdul Mateen Sahak et son épouse ont jailli de leur chambre pour trouver leurs huit enfants déjà alignés dans le couloir. « J’ai immédiatement pensé à Hérat », confie le médecin afghan de 48 ans, en référence aux tremblements de terre qui ont dévasté cette province de l’ouest du pays en 2023. « J’étais sûr que l’impact serait là aussi immense ».
Originaire de la région, le Dr Sahak savait les effets qu’une telle catastrophe aurait sur les villages de montagne du nord-est, où des familles nombreuses vivent sous un même toit dans des zones reculées et difficiles d’accès. En un clin d’œil, les murs fragiles de leurs maisons de pierre s’effondreraient. Les routes arpentées menant à leur hameau disparaîtraient sous les éboulis. Des foyers entiers seraient ensevelis dans leur sommeil.
Les premiers appels
À la tête du bureau régional des urgences sanitaires de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Sahak s’est aussitôt tourné vers son groupe de coordination sur WhatsApp. Les premiers rapports provenaient de Kounar, une province voisine le long de la frontière pakistanaise, la plus durement touchée par le séisme. Depuis sa capitale, Assadâbâd, l’hôpital central signalait déjà de possibles victimes.
Vers une heure du matin, les messages se faisaient plus pressants : « Nous recevons des blessés de partout. La situation est grave. Si possible, envoyez du renfort ! ».
Une course contre la mousson
En pleine nuit, le médecin a donné rendez-vous à son équipe dans les entrepôts de l’OMS à Jalalabad. En chemin, la pluie tombait à torrent – la mousson, qui allait compliquer les premiers secours, des atterrissages d’hélicoptères aux évacuations en ambulance, dès les premières heures du désastre.
La mécanique humanitaire s’est pourtant mise en marche. Des caisses de médicaments ont été chargées sur un camion, acheminées à l’aéroport, puis transportées par un hélicoptère du ministère de la défense vers le district de Nourgal, au cœur de la catastrophe. « Heureusement, nous avons pu atteindre rapidement la zone la plus touchée », dit-il.
« J’ai immédiatement pensé à Hérat », confie le médecin afghan de 48 ans, évoquant les tremblements de terre qui avaient dévasté cette province de l’ouest du pays en 2023. « J’étais sûr que l’impact serait là aussi immense ».
Un paysage de désolation
Avec l’aide de deux ONG locales, il a immédiatement mobilisé une équipe d’une vingtaine de médecins, infirmiers et pharmaciens – dont six femmes – dépêchés sur place par voie aérienne.
Lui a pris la route avec trois de ses collègues de l’OMS.
Déjà, les premiers bilans s’alourdissaient. On parlait de 500, peut-être 600 morts. Une semaine après le tremblement de terre, le décompte officiel dépassait les 2.200 morts, 3.600 blessés et 6.700 maisons détruites.
À bord de leur véhicule blindé, ce lundi 1er septembre, le Dr Sahak et son équipe avançaient difficilement. « Beaucoup de routes étaient coupées à cause des énormes pierres qui tombaient des montagnes ». Sur les voies encore praticables, les foules ralentissent la circulation : des milliers de civils, à pied pour la plupart, venus porter secours aux victimes.
« Où est mon bébé ? »
Lorsqu’en début d’après-midi, son équipe est parvenue à rallier le district de Nourgal, le médecin, pourtant rompu aux crises humanitaires, était choqué par l’ampleur du désastre. « Il y avait des corps dans la rue. On attendait que les familles viennent les enterrer ». Des volontaires affluaient des districts avoisinants pour déblayer les gravats, transporter les blessés et recueillir les morts.
Il se souvient d’un homme d’une soixantaine d’années, en pleurs. Sa peau semblait brûlée. Il était dans un état critique après l’écroulement de la maison, dans laquelle il vivait avec trente membres de sa famille. Seuls huit d’entre eux avaient survécu. « C’était bouleversant », confie-t-il. « Je ne parvenais pas à soutenir son regard ».
À la clinique locale, fissurée par les secousses, le personnel soignant prenait en charge un nombre croissant de blessés sous des tentes dressées à l’extérieur.
Il y avait là une femme avec des blessures multiples : fracture du bassin, traumatisme crânien, côtes cassées. Elle sanglotait et avait du mal à respirer. « Elle répétait sans cesse : “Où est mon bébé ? Je veux mon bébé ! Ramenez-moi mon bébé !” », raconte le médecin, avant de marquer une pause. « Non… elle avait perdu son bébé… toute sa famille ».
Une semaine après le tremblement de terre du 31 août, le décompte officiel dépassait les 2.200 morts, 3.600 blessés et 6.700 maisons détruites.
Les femmes à l’avant-poste
Dans un pays où les femmes sont sous le coup de restrictions drastiques qui les mettent à l’écart de l’espace public, le séisme a momentanément fait tomber les barrières. « Durant les premiers jours, tout le monde, hommes et femmes, participait aux secours », assure le responsable de l’OMS.
Les femmes médecins et infirmières peuvent travailler à l’hôpital en Afghanistan, à condition qu’elles soient accompagnées par un parent masculin. Mais l’exode massif des professionnelles de santé depuis le retour des talibans, en 2021, pèse lourd sur le système. « La plupart des spécialistes, surtout les femmes, ont quitté le pays », souligne le Dr Sahak. « Nous peinons à trouver du personnel qualifié ».
Sa propre fille aînée en a payé le prix. Étudiante en médecine à Kaboul, elle a dû interrompre ses études après l’interdiction faite aux femmes d’accéder à l’université. « Aujourd’hui, elle est à la maison », dit-il. « Elle n’a aucune chance d’achever ses études ».
L’héroïsme ordinaire
Face au désastre, la mission de l’OMS consistait à maintenir les cliniques debout en leur fournissant des médicaments, des consignes claires et même des encouragements. « Nous leur disions : vous êtes des héros ! », rapporte le médecin.
Pendant ce temps-là, à Jalalabad, sa famille vivait dans l’angoisse de son retour. Quand, enfin, il a pu rentrer chez lui ce premier soir, sa mère de 85 ans s’est jetée à son cou. « Elle m’a étreint pendant plus de dix minutes », se souvient-il. « Elle m’a supplié de ne plus repartir ». Mais dans les districts de Nourgal, Chawkay, Dara-i-Nur ou encore Alingar, des dizaines de milliers d’habitants n’avaient que l’OMS pour survivre.
Le lendemain matin, il était de nouveau sur la route.
Le 2 septembre 2025, le Dr Abdul Mateen Sahak et son équipe de l’OMS vont à la rencontre de deux femmes, une mère et sa fille, à l’hôpital régional d’Assadâbâd, dans la province de Kounar. Tous les membres de leur famille avaient péri dans le tremblement de terre du 31 août 2025.
Le registre des vivants et des morts
Cinq jours après la catastrophe, les chiffres consignés par le Dr Sahak illustraient l’ampleur de l’effort : 46 tonnes de matériel médical distribuées, plus de 15.000 poches de perfusion livrées, 17 équipes de surveillance déployées pour prévenir les épidémies redoutées après la destruction des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
L’OMS demandait 4 millions de dollars pour poursuivre son action et étendre ses services mobiles de santé. Déjà, 800 patients graves avaient été évacués vers Jalalabad et des centaines d’autres en direction du principal hôpital d’Assadâbâd, où le médecin s’est également rendu avec son équipe le deuxième jour.
Les mots d’une mère
C’est là que, à l’ombre d’un mûr de l’établissement, ils sont allés à la rencontre de deux rescapées : une femme et sa fille. Elles venaient de sortir d’hôpital et ne savaient pas où aller. Tous les membres de leur famille avaient péri dans le tremblement de terre. La plus jeune, agée d’une vingtaine d’années, était incapable de parler. Des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues.
Ému par leur détresse, le Dr Sahak a demandé à l’hôpital de les garder quelques jours de plus, ce que le directeur a accepté. Le soir venu, il a raconté la scène à sa famille. « Tout le monde pleurait. Ils étaient tellement affectés qu’ils n’ont même pas pu dîner », dit-il.
Sa mère qui, la veille encore, le suppliait de rester, avait fini par changer d’avis. « S’il te plait », lui dit-elle. « Va aider les gens ».
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.com).
To submit your press release: (https://www.globaldiasporanews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.globaldiasporanews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.globaldiasporanews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.