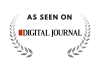Devant le Conseil de sécurité, jeudi, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Inger Andersen, l’a résumé d’une phrase : « Les dégâts environnementaux causés par les conflits poussent des populations entières vers la faim, la maladie et le déplacement – augmentant l’insécurité ».
À Gaza, a-t-elle rappelé, « 97 % des cultures arboricoles, 95 % des arbustes et 82 % des cultures annuelles ont disparu depuis 2023 ». L’eau y est souillée par les munitions et les eaux usées, et « 61 millions de tonnes de débris » doivent être déblayées sans aggraver la contamination. En Syrie, la destruction du barrage de Kakhovka a inondé plus de 600 km² de terres, tandis qu’en Haïti, l’érosion et la pollution des eaux font resurgir le spectre du choléra. Partout, les guerres abîment la nature au-delà du visible : les sols s’appauvrissent, les nappes phréatiques s’empoisonnent, les écosystèmes s’effondrent.
Montagne de déchets à Gaza (avril 2025).
Le climat, nouveau catalyseur des tensions
Mais le dérèglement climatique, lui aussi, devient un fauteur de guerre. Inger Andersen l’a décrit comme « une pelure d’oignon » : un facteur qui s’ajoute aux tensions religieuses, ethniques ou foncières, les envenime et précipite les crises.
Des plaines sahéliennes aux plateaux afghans, la raréfaction de l’eau, les récoltes perdues et les incendies de forêt provoquent des déplacements massifs et des rivalités nouvelles.
Un droit international encore insuffisant
Le juriste sierra-léonais Charles C. Jalloh, membre de la Commission du droit international, a souligné l’ampleur du vide juridique face à ces dévastations. Si les Conventions de Genève interdisent les guerres « causant des dommages étendus, durables et graves à l’environnement », le seuil de preuve est, selon lui, « trop élevé et trop imprécis pour être appliqué dans la plupart des cas ».
Les textes de droit humanitaire ont été conçus pour les guerres entre États, non pour les conflits internes qui ravagent aujourd’hui le Yémen, la Syrie ou le Soudan.
Une jeune fille se lave le visage dans un camp de personnes déplacées par le tremblement de terre dans la province de Kunar, en Afghanistan.
Vers une reconnaissance du crime d’écocide
Pourtant, le droit international évolue. Le professeur Jalloh a salué les 27 principes adoptés par la Commission du droit international en 2022, qui étendent la protection de la nature aux conflits internes et aux occupations militaires. Le principe 7 impose aux États et aux Nations Unies de « prévenir, atténuer et réparer les dommages environnementaux liés aux opérations de paix ». À Gaza, a-t-il rappelé, ces obligations s’appliquent déjà à la puissance occupante : « Les activités sur le territoire occupé ne doivent pas causer de préjudice significatif à l’environnement d’autres États ou zones hors juridiction nationale ».
M. Jalloh a appelé à combler les failles du système : inscrire les atteintes massives à la nature dans le droit pénal international et reconnaître le crime d’écocide au même titre que les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité. Il a également proposé la création d’un mécanisme onusien de suivi et d’indemnisation pour les dommages environnementaux liés aux conflits. « L’environnement n’est pas une abstraction, a-t-il rappelé, mais le cadre vital et la santé même des êtres humains, y compris des générations à naître ».
Haïti, laboratoire des crises croisées
Ce débat pouvait sembler théorique, jusqu’à ce que le Conseil se concentre sur l’exemple d’Haïti. Dans ce pays en proie à la violence des gangs et dévasté, la semaine dernière, par le passage de l’ouragan Melissa, la déforestation a fait disparaître 98 % du couvert forestier. Les collines dénudées s’éboulent, les rivières charrient la boue et les déchets, et chaque tempête emporte les récoltes. Maranata Dinat, responsable des interventions d’urgence à l’ONG World Relief, en Haïtie, a mis des visages sur ces chiffres : « Imaginez une mère vivant dans l’un des quartiers les plus vulnérables de la capitale. Sa maison, déjà fragilisée par l’érosion, est inondée après de fortes pluies. Elle est forcée de fuir avec ses enfants, traversant des zones contrôlées par des gangs pour rejoindre un camp improvisé ».
Des agences de l’ONU distribuent de l’aide humanitaire à Bassin Bleu, en Haïti, une localité attaquée par des gangs en septembre 2025.
Haïti, où se superposent catastrophes climatiques, violences urbaines et déplacements forcés, illustre le cercle vicieux décrit par les experts : « L’insécurité provoque le déplacement, le déplacement expose à de nouveaux risques climatiques, et les chocs climatiques, à leur tour, aggravent les tensions sociales et la compétition pour les ressources », a dit Mme Dinat.
Pour en sortir, la représentante de la société civile a appelé à cesser de traiter séparément les crises humanitaires, climatiques et sécuritaires : « Haïti fait face à une crise environnementale qui est, au fond, une crise humaine et sécuritaire. Les réponses doivent s’ancrer dans la restauration des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la gouvernance locale ».
Protéger la planète pour prévenir la guerre
Au fil des interventions au Conseil, une conviction s’est imposée : la paix ne se bâtira pas sur des terres dévastées. Comme l’a résumé Inger Andersen, du PNUE, à propos du réchauffement climatique, « chaque fraction de degré évitée signifie moins de pertes pour les populations et les écosystèmes – et davantage de chances pour la paix et la prospérité ». Derrière les traités, les principes et les chiffres, c’est une même idée qui refait surface : protéger la planète, c’est empêcher la guerre de s’enraciner dans dans la terre.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.com).
To submit your press release: (https://www.globaldiasporanews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.globaldiasporanews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.globaldiasporanews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.