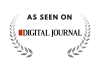Le 22 septembre, au siège de l’ONU à New York, un sommet mondial réunissant des chefs d’État et de gouvernement – parrainé par la France et l’Arabie saoudite – tentera de relancer la « solution à deux États » : l’un israélien, l’autre palestinien, coexistant à l’intérieur de frontières sûres et reconnues.
En avril dernier, devant le Conseil de sécurité, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, avait averti que ce processus était « sur le point de disparaître ». La volonté politique pour y parvenir, avait-il ajouté, « paraît plus éloignée que jamais ».
Plus récemment, lors d’un échange avec des journalistes, il a déclaré « Quelle est l’alternative ? Est-ce une solution à un seul État, dans laquelle soit les Palestiniens sont expulsés, soit ils sont condamnés à vivre sur leur terre dépourvus de droits ? ».
Il a souligné qu’il était « du devoir de la communauté internationale de maintenir vivante la solution à deux États, puis de créer les conditions permettant de la concrétiser ».
Voici quelques clés pour comprendre les enjeux de cette conférence.
En 1949, un convoi transporte des réfugiés palestiniens et leurs biens de Gaza à Hébron, en Cisjordanie.
De quoi s’agit-il ?
- L’idée de créer deux nations distinctes, l’une juive et l’autre palestinienne, vivant en paix côte à côte, est antérieure à la fondation des Nations Unies en 1945. Retravaillé à de nombreuses reprises depuis, ce concept est présent dans des dizaines de résolutions du Conseil de sécurité, plusieurs cycles de pourparlers de paix et dans la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale, récemment reprise.
- En 1947, la Grande-Bretagne porte la « question de Palestine » devant l’ONU, qui accepte la responsabilité de trouver une solution équitable. L’Organisation propose le partage de la Palestine en deux États indépendants, l’un arabe palestinien et l’autre juif, avec un statut international pour Jérusalem : une esquisse de la solution à deux États.
- En 1991, la conférence de Madrid vise à parvenir à un règlement pacifique par des négociations directes, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de sécurité.
- Deux ans plus tard, en 1993, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat, signent les accords d’Oslo, qui posent les principes de futures négociations et jettent les bases d’une autonomie palestinienne provisoire en Cisjordanie et à Gaza.
- Certaines questions sensibles sont renvoyées à des négociations ultérieures sur le statut final, organisées à Camp David en 2000 puis à Taba en 2001, sans aboutir.
Trente ans après Oslo, l’objectif affiché des Nations Unies reste le même : aider Israéliens et Palestiniens à régler le conflit et à mettre fin à l’occupation, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU, au droit international et aux accords bilatéraux. La vision poursuivie est celle de deux États – Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, contigu, viable et souverain – vivant côte à côte en paix et en sécurité, dans des frontières sûres et reconnues, sur la base des lignes d’avant 1967, avec Jérusalem comme capitale commune.
Pour d’avantage d’information sur les origines de la solution à deux États et les principaux enjeux, veuillez consulter notre rétrospective historique et notre chronologie.
Une habitante d’une colonie de peuplement israélienne passe à proximité d’un soldat israélien à Jérusalem-Est (photo d’archive).
À quoi s’attendre le 22 septembre ?
Prévu le premier jour de la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale – ce grand rendez-vous diplomatique annuel de septembre – le sommet se déroule dans un contexte régional particulièrement inquiétant : intensification des opérations militaires israéliennes, qui ont causé la mort de plus de 60.000 personnes à Gaza, depuis le 7 octobre 2023 ; déclaration officielle d’un état de famine dans le nord de Gaza, le 22 août ; frappes israéliennes visant des responsables du Hamas au Qatar, le 9 septembre ; et accélération de la colonisation en Cisjordanie.
Malgré cette conjoncture explosive, la solution à deux États reprend de la vigueur sur le plan diplomatique.
Le 12 septembre, l’Assemblée générale a adopté à une large majorité la « Déclaration de New York », à la suite d’une conférence organisée en juillet, également coparrainée par la France et l’Arabie saoudite. Elle appelle à une « paix juste et durable, fondée sur le droit international et sur la solution à deux États ».
Pour mettre fin à la guerre, la déclaration exhorte le Hamas à « mettre un terme à son rôle à Gaza et à remettre ses armes à l’Autorité palestinienne ». Les États-Unis et Israël, qui avaient boycotté la conférence de juillet, ont voté contre ce texte.
Le sommet du 22 septembre devrait s’appuyer sur cette dynamique.
- Le président français, Emmanuel Macron, devrait annoncer la reconnaissance par la France de l’État de Palestine.
- D’autres pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, le Canada, la Belgique et l’Australie, envisageraient de lui emboîter le pas.
En résumé : ce sommet pourrait insuffler un nouvel élan aux efforts visant à établir une feuille de route onusienne vers deux États.
Source of original article: United Nations (news.un.org). Photo credit: UN. The content of this article does not necessarily reflect the views or opinion of Global Diaspora News (www.globaldiasporanews.com).
To submit your press release: (https://www.globaldiasporanews.com/pr).
To advertise on Global Diaspora News: (www.globaldiasporanews.com/ads).
Sign up to Global Diaspora News newsletter (https://www.globaldiasporanews.com/newsletter/) to start receiving updates and opportunities directly in your email inbox for free.